-Enfance et adolescence
Enfance et jeunesse au Parc Albert à Ganshoren – 1960-1990.
En 1959-1960, mes parents, Alfred et Henriette Van Nieuwenhuysen-Pièrard ont fait construire la maison que mon épouse Jacqueline, nos enfants Henri et Camille ainsi que moi-même occupons actuellement (avenue Mathieu De Jonge 34). Etant né en 1955, j’étais donc dans ma cinquième année lorsque ma famille s’établit dans la demeure nouvellement construite. C’était l’âge de l’insouciance et des jeux et le « parc Albert » de l’époque s’y prêtait à merveille. A l’endroit où s’étendent actuellement les terrains de tennis et le terrain de football, on trouvait des marécages où les gamins du cru allaient pêcher des tritons et grenouilles, dont certaines atteignaient une taille respectable, sautant sans difficulté par-dessus les parois du seau dans lequel on les avait déposées. L’étang qui sert de trop-plein à celui du château de Rivieren n’était pas encore enclos, de sorte qu’on pouvait également y attraper des batraciens. Lors de leur période de reproduction, les grenouilles y menaient un tel vacarme que leurs coassements troublaient pendant quelques jours le sommeil des riverains.
De notre quartier, les maisons bordant les avenues Mathieu De Jonge, Richard Mazza et des Troubadours, la drève du Château (tronçon entre l’actuel « Chaudron d’or » et l’entrée du Château) ainsi que les squares des Privilèges, des Oriflammes et de la Diligence furent d’abord construites. L’autre partie du quartier, qu’on appelait « le nouveau quartier » (avenues des Quatre-vingts hêtres et Henri Feuillien, de même que le clos des Tarins) ne fut bâtie que dans le courant des années 1960. Bruxelles s’arrêtait à la fin de l’avenue Mathieu De Jonge, au rond-point de l’avenue de la Réforme et de la drève de Rivieren (au Magasin « Fin Gourmet ») et au croisement de l’avenue Van Overbeke et de la rue de l’Eglise Saint-Martin. Tout ce qui se trouvait à l’ouest de ces points, hormis la vénérable rue Zeyp, alors encore pavée et très pittoresque, n’était que terrains vagues, marais et campagnes. De formidables terrains de jeu.
A l’endroit où se trouve aujourd’hui le terrain de football du parc Albert, on avait apporté des terres de remblais, créant des « collines », dont les gamins se disputaient la possession. On y construisait des camps retranchés avec des pistes de départ pour les vélos de ceux qui devaient intercepter l’ennemi. Souvent, des plaques de tôle ondulée recouvraient les fortifications et produisaient un bruit terrible à l’impact des mottes de terre que les protagonistes se canardaient à l’envi. A la fin d’une journée de jeu, j’étais à ce point crotté et plein de sable que ma mère me faisait déshabiller dans le garage avant de m’amener à la salle de bain pour m’y récurer.
Le domaine de Rivieren, avec ses château et étang ceints d’un bois qui les soustrayait aux regards, nous était totalement interdit. Des récits se colportaient faisant état d’un garde particulièrement vigilant accompagné de chiens et muni d’un fusil chargé de gros sel. Par contre, les voisins du domaine avaient droit à la visite des paons de la comtesse. Ils devaient être une petite dizaine et comprenaient deux mâles, un vieux et un jeune, magnifiques lorsqu’ils faisaient la roue. Malheureusement, après le décès de la comtesse (01.12.1973), ces animaux furent laissés à l’abandon, de sorte que leur nombre décrut rapidement. Il ne resta pour finir que deux femelles, pas jolies du tout et semblables à de grosses pintades. Elles venaient dans les jardins pour y picorer les semis et cribler de coups de becs les cache-pots en frigolite ; les gens en avaient pitié et les nourrissaient volontiers. Leur souvenir me remémore une anecdote que je ne résiste pas à vous conter : la maison sise au numéro 25 de l’avenue Mathieu de Jonge était habitée par Monsieur et Madame Humbert. La demeure fait face à notre maison. Humbert était, je crois, juge au tribunal du travail. Il avait été élevé en Grande-Bretagne durant la guerre 14-18 et affichait en toutes circonstances le flegme qui allait de pair avec son éducation. En 1940, il était retourné en Albion pour prendre part à la bataille d’Angleterre comme pilote de la RAF. Rarement, à l’occasion de cérémonies, il revêtait son uniforme dans lequel il avait fière allure. Chaque jour de la semaine et à heure régulière, Monsieur Humbert revenait de son travail à son domicile, conduisant sa Wartburg à moteur deux temps au bruit caractéristique. Sa voiture rentrée au garage, il se munissait d’outils de jardinage pour entretenir son impeccable garden. Un jour, une paonne s’était installée dans une grande vasque placée devant la maison du magistrat (là où se trouvent à présent des cyprès). L’animal avait auparavant pris grand soin de racler de ses pattes griffues une partie de la terre de la vasque afin d’y pratiquer une cavité dans laquelle s’installer. Inutile de préciser que, ce faisant, elle avait envoyé dinguer les fleurs que notre homme y faisait pousser avec amour. Y ayant pondu un œuf de taille considérable, l’oiseau était ensuite parti rejoindre ses congénères. Animés d’un réflexe bien peu charitable mais irrésistible, ma mère et moi nous étions postés derrière la fenêtre du salon, guettant la réaction du ponctuel Monsieur Humbert rentré de son travail. Il ne s’aperçut d’abord de rien, rentrant son auto au garage, comme à l’accoutumée. C’est seulement quand il sortit pour aller jardiner qu’il avisa l’œuf et le carnage causé par la paonne. L’expression de son visage ne dura que l’espace d’un instant mais valait réellement l’attente. La stupeur ne fut cependant que de courte durée. Le jardinier entreprit sur le champ de remettre sa vasque en état et ne se départit nullement de son calme tellement British. Ce jour là , on se paya une solide pinte de bon sang.
La comtesse de Villegas de Saint-Pierre Jette était une Bretonne, née Elisabeth de Botmiliau. C’était une dame âgée aux cheveux blancs frisés comme la toison d’un mouton. Elle conduisait encore sa voiture et allait à Jette faire ses courses en toute simplicité chez « Priba » (l’actuel « Carrefour » de la rue Léopold). Elle patronnait une consultation de nourrissons qui avait lieu dans une petite maison de la place Guido Gezelle (devant le « Café des Sports »). Sur une des fenêtres du bâtiment, on voyait les armoiries comtales qui à l’époque piquaient ma curiosité.
Lorsque la commune de Ganshoren résolut de construire les maisons de jeunes, ce fut la levée de boucliers dans le voisinage qui redoutait les nuisances qu’une telle implantation ne manquerait pas d’apporter dans un quartier résidentiel et tranquille. Protestations, pétition, interventions auprès de membres de la majorité communale et de l’opposition, rien n’y fit : les maisons furent construites au grand dam des riverains. Un soir, la maison des jeunes flamande fut ravagée par un incendie mais elle fut reconstruite très rapidement. Dans un tout autre contexte, le quartier demanda et obtint le barrage de l’avenue Joseph Peereboom à la circulation. Il faut dire que la mise en communication directe des avenues Mathieu De Jonge et des Quatre-Vingts Hêtres avec l’avenue Van Overbeke via l’avenue Peereboom n’avait pas manqué d’attirer des amateurs de courses folles à motocyclette et même en voiture. Vu le danger, surtout pour les enfants et personnes âgées, la décision de nos édiles était la sagesse même et il faut se réjouir qu’ils l’aient maintenue jusqu’à présent.
A la place où se trouve actuellement la maison de jeunes francophone, on avait déposé un vieux bus de la STIB, dont les garnements du quartier firent rapidement leur point de ralliement. C’était un « camp » rêvé, point de départ de raids dans les environs et dans les marais. Un beau jour, le bus, ou plutôt la carcasse qui en restait, fut pris en remorque par un camion et amené vers une destination inconnue. C’est le cœur lourd que mes copains et moi virent partir ce témoin de tellement de nos jeux.
Devant la maison des jeunes francophone, on avait érigé une haute antenne comme récepteur pour la télévision. Elle rappelait un peu la tour Eiffel. Un jour, lorsqu’une équipe de sportifs avait entrepris d’escalader le célèbre monument parisien, événement dont on parlait abondamment au journal télévisé, l’idée nous vint de réaliser le même exploit sur « notre » tour. Equipés de cordes et de mousquetons, nous entreprîmes donc l’ascension. Alertée par des voisines, à juste titre inquiètes de notre témérité, notre police communale ne tarda point à rappliquer. Un agent nous intima en hurlant l’ordre de descendre incessamment. Après avoir obtempéré, nous eûmes droit à un savon « maison ». Le policier nous dit aussi qu’il passerait en soirée chez nous pour voir nos parents. Heureusement, il se souvint sans doute qu’il avait aussi été gamin et il n’en fit rien. Nous en étions donc quittes pour l’engueulade.
A l’embranchement des deux voies de chemin de fer, l’une vers Gand-Saint-Pierre et l’autre en direction de Termonde, on voit toujours une longue construction en briques au toit plat. Un jour, un quidam alla peindre le nom FAYAT à la peinture sur le côté du bâtiment tourné vers le parc Albert. L’inscription demeura longtemps visible. Fayat était un socialiste Bruxellois flamand natif de Molenbeek-Saint-Jean, fondateur du mouvement De Rode Leeuwen.
L’actuel marais de Jette Ganshoren, alors considéré comme « terrains vagues » était pour nous un formidable espace de jeu. Une élévation créée par des remblais du chemin de fer et au sommet dépourvu de végétation s’appelait « la montagne blanche ». Nous y avions évidemment installé un « camp » d’où on contrôlait une partie de la vallée de la Molenbeek. Près de là , le long de la petite rue Sainte-Anne, à l’endroit où se trouve un local technique de l’I.B.G.E . en bordure de la réserve naturelle de la CEBO, se trouvaient quelques maisonnettes. L’homme qui y résidait nous avait pris en grippe et menaçait de nous attraper, de nous ligoter et de nous amener au commissariat de police. Il nous reprochait d’effrayer ses pigeons en faisant éclater des pétards et, à juste titre, il nous soupçonnait d’être les auteurs d’incendies de broussailles que nous allumions l’été lorsque la végétation était sèche. Plusieurs fois ces « exploits » nécessitèrent l’intervention des pompiers. Quand je réalise à présent le mal fait alors à la flore et aux animaux, je ne suis pas fier d’avoir participé à ces actions. Mais on n’en était pas encore à heure de l’écologie et de la protection du peu de nature qui nous est resté.
Comme le parc de Rivieren, le Laerbeekbosch nous fut longtemps interdit, tant que le chalet normand resta habité. Il y avait un garde et en automne, on chassait dans le bois. Le Poelbosch et son grand étang étaient féeriques mais devinrent rapidement une réserve naturelle dont l’accès nous était également fermé.
J’allais souvent promener avec mon père autour et plus tard dans le Laerbeekbosch. Il y observait les oiseaux et étudiait les champignons qu’il cueillait et ramenait à la maison pour les dessiner au moyen de ses crayons Caran d’Ache. Je possède toujours ses croquis. La face du bois tournée vers l’actuel UZ Brussel était particulièrement champêtre avec ses petites maisons de paysans dont l’une, la « Huize Lorebeke » était occupée par Jan Verdoodt, peintre jettois de renom.
J’ai encore connu l’actuel restaurant « Au Chaudron d’Or » occupé par des maraîchers chez qui nous allions acheter des légumes. Il fut ensuite acquis par un restaurateur de Waterloo, Norbert Brassine. Lors des travaux d’aménagement de la fermette en rôtisserie, je me souviens lui avoir parlé en compagnie de copains. Il m’avait impressionné avec sa grosse tête sur laquelle il portait un béret basque, alors qu’il dévorait un pistolet fourré d’américain. Il me semblait être un cannibale. J’ai conté par ailleurs l’histoire de l’enseigne de cette maison de bouche appelée « Vieux Diable », traduction erronée du nom d’un de ses anciens occupants.
A l’époque, peu de ménages possédaient deux voitures. Nous n’en avions qu’une et, de toute façon, maman ne savait pas conduire. Résultat : pour aller faire des courses, il fallait monter à Jette Miroir à pied ou en tram. Dans le quartier, il y avait quelques magasins d’alimentation générale assez bien achalandés : en autres la supérette « A l’Etoile » alias chez Jeunommeke, comme nous disait la tenancière lorsque nous allions y faire des achats, au croisement de l’avenue de l’Exposition universelle et de la drève de Rivieren (aujourd‘hui numéro 151), « Au fin Gourmet », au rond-point de la drève de Rivieren (actuel numéro 59 de l’avenue de la Réforme). Ce commerce, très bien achalandé et d’une propreté impeccable était tenu par deux vieilles demoiselles originaires de Lembeek. Il fallait bien s’y comporter et il n’était pas question de toucher les friandises. Qui ne se conformait pas à ces règles était prié de sortir immédiatement. La limite étant mise, les jeunes s’y tenaient. Il y avait un boulanger dans l’avenue Beethoven (numéro actuel 2A) et, après la construction de l’immeuble sis 85, drève de Rivieren, il y eut le pharmacien Bergmann, dont les enfants ont repris l’officine. Au numéro 21 de l’avenue Mathieu De Jonge, on avait l’atelier de la firme « Thermomatic », qui concevait et plaçait des installations de chauffage central. Mais le commerce qui a laissé les plus vifs souvenirs dans mon esprit est celui de Reneï, à l’actuel numéro 69 de la drève de Rivieren (esthéticienne Eden’s Garden). C’était une épicerie qui avait tout du parfait « bollewinkel ». Les produits qu’on y vendait étaient souvent d’une qualité douteuse. Je me souviens d’une boîte de biscuits, achetée par ma maman. Les « couques » étaient tellement vieilles qu’elles se désagrégeaient à la moindre manipulation… Reneï vendait également des sucreries diverses : cachets surs, lacets noirs à l’anis, petites barres de chocolat de fantaisie, etc. On pouvait tout toucher et se servir soi-même. Lorsqu’on payait, Reneï, toujours bougon, prenait avidement l’argent et disait « çi » (= merci) et « voir » (= au revoir). C’était un petit vieux fluet portant un éternel cache-poussière gris et une casquette vissée sur le crâne. Par contre, son épouse était une imposante matrone. Reneï était fréquemment l’objet de nos niches : nous allions pousser la porte du magasin et faire retentir la sonnerie, composée de petites barres de fer qui tintinnabulaient à l’ouverture de la porte. Reneï, alerté, venait dans le magasin pour constater qu’il n’y avait personne, alors que la porte était ouverte. Réfugiés sur le trottoir de l’avenue Mathieu de Jonge, nous lui faisions des pieds de nez et nous gaussions de lui, alors qu’il nous montrait le poing. Lorsqu’il neigeait, les plus hardis d’entre nous attendaient, après avoir poussé l’huis, que Reneï apparaisse dans l’échoppe. Il était alors la cible de boules de neige « calées » à bout portant.
Pour aller « en ville », on prenait soit le bus 87 à son terminus de l’avenue Van Overbeke (devant l’actuel boulanger, numéro 65 de la rue de l’Eglise Saint-Martin) ou le tram 13 à son terminus au square du Centenaire. Il fallait aller à Bruxelles pour tout achat important, notamment pour des vêtements et chaussures. Il y avait aussi le « Bon Marché », particulièrement attrayant à la période de Saint-Nicolas. Une année, c’est la fusée lunaire d’ « Objectif Lune » qui menait aux étages et au trône du saint de tous les enfants sages… et des autres, comme moi.
A tout ce petit monde, une fin brutale fut mise pour moi le premier juin 1990. Rentrés à la maison après une sortie à Beersel et le dernier verre chez des amis, ma mère et moi retrouvâmes notre maison cambriolée. Tout y était sens dessus-dessous et il régnait une forte odeur de patchouli, qu’ aujourd’hui encore, j’associe à ce moment dès que je la sens. C’était la fin d’une époque : le parc Albert était rattrapé par la ville et par ses maux : criminalité, urbanisation, etc. Notre quartier reste néanmoins un lieu où il fait très bon vivre et notre P.L.P. contribue à ce que notre qualité d’existence soit maintenue.
P. Van Nieuwenhuysen
Mars 2012 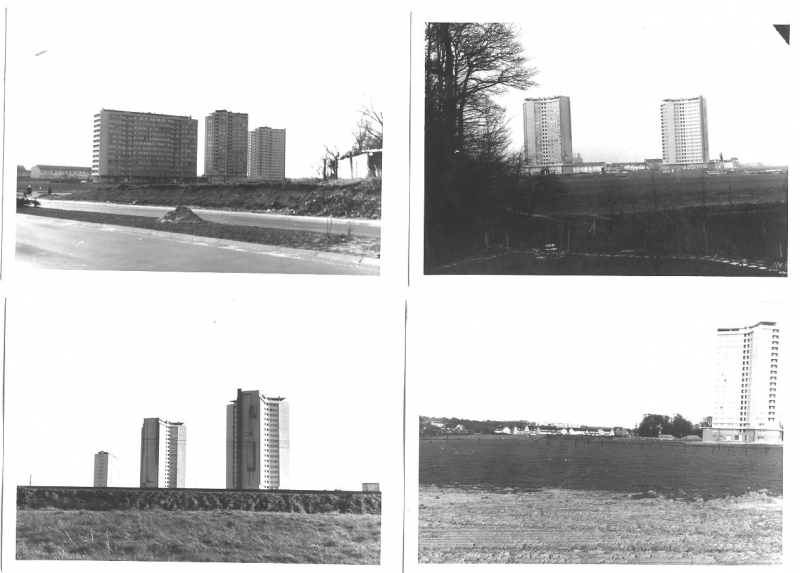 |